juillet 2018
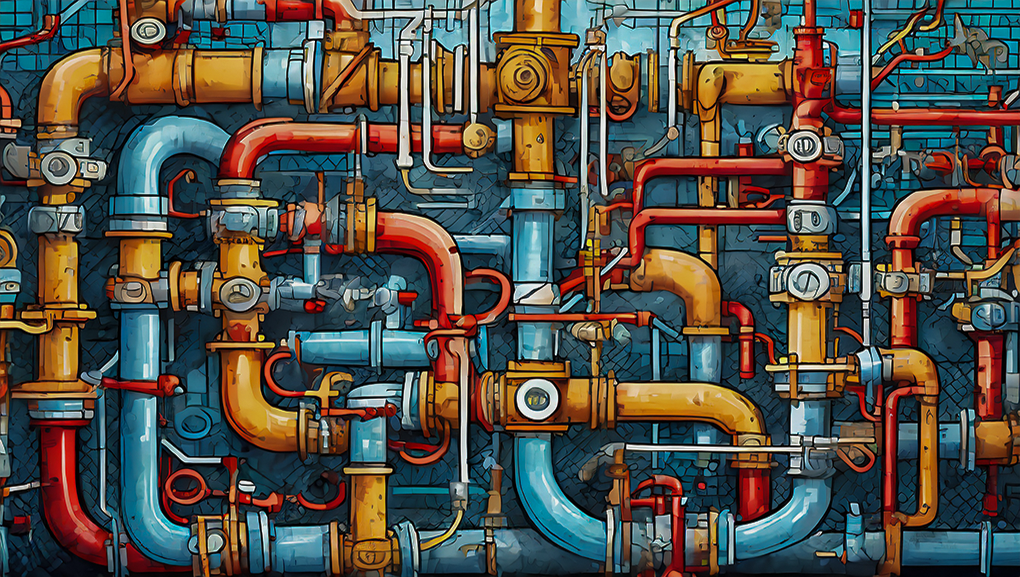
La circulation des modèles

La circulation transnationale
du modèle du district artistique
Le cas des Gillman Barracks à Singapour
La circulation transnationale du modèle du district artistique : le cas des Gillman Barracks à Singapour,
Riurba no
6, juillet 2018.
URL : https://www.riurba.review/article/06-modeles/singapour/
Article publié le 1er juil. 2018
- Abstract
- Résumé
The transnational circulation of the art district model: the case of the Gillman Barracks in Singapore
This article studies the circulation of the art district model and analyses the transformation of a former colonial military barracks complex in Singapore, the Gillman Barracks, into an artistic destination. This study shows the art district model’s blurriness and flexibility character favours its circulation. Its initial rationale can be transformed as it gets adopted in a new context: conceived initially as a tool to foster creation, the art district model was mobilised as an instrument of urban promotion by the Singaporean government. The city-State has a long experience mobilizing international references to elaborate its own exportable model, in fields such as housing, economic development or transportation policies. But the chaotic trajectory of the Gillman Barracks project shows that Singapore struggles to impose its cultural policy as a model. Meanwhile, within this new transnational space, external references progressively become a resource to build a new narrative, on the margins of the “Singaporean model”.
Cet article étudie la circulation du modèle du district artistique et analyse la transformation d’un ancien complexe de casernes coloniales à Singapour, les Gillman Barracks, en destination artistique. Cette étude montre que le caractère flou et malléable du modèle de district artistique favorise sa circulation. L’appropriation d’un tel modèle dans un contexte nouveau peut donner lieu à une transformation du rationnel initial : conçu initialement au prisme de la création, le district artistique a été mobilisé par le gouvernement singapourien comme un instrument de promotion urbaine. La cite-État dispose d’une longue expérience consistant à s’approprier des références internationales afin d’élaborer un modèle exportable, dans des domaines aussi divers que le logement, la politique économique ou le transport. Mais la trajectoire chaotique du projet des Gillman Barracks montre que Singapour peine à imposer sa politique culturelle comme un modèle. Cependant, dans ce nouvel espace transnational, les références extérieures deviennent progressivement une ressource pour construire un nouveau narratif, aux marges du « modèle singapourien ».
post->ID de l’article : 3910 • Résumé en_US : 3928 • Résumé fr_FR : 3925 •
Introduction
La cité-État de Singapour s’est constituée comme un modèle. S’inspirant largement de références extérieures, elle est parvenue à se voir reconnaître comme un exemple à suivre, à la faveur de son développement économique fulgurant et de la coexistence pacifique des différentes ethnies qui composent sa population (Chua, 2011[1]Chua BH. (2011). “Singapore as model”, dans Roy A, Ong A (eds.), Worlding cities: Asian experiments and the art of being global, Oxford, Wiley-Blackwell.). En 2012, le gouvernement singapourien inaugure un nouveau district artistique, les Gillman Barracks. Dans cet ancien complexe de casernes de l’époque coloniale, où sont établies des galeries d’art, un musée et des résidences artistiques, les références de territoires célèbres, tels que Chelsea à New York ou 798 à Beijing, sont constamment mobilisées. Mais peut-on effectivement importer un district artistique ?
Depuis les années 2000, les districts artistiques se sont multipliés (Brones et Moghadam, 2016[2]Brones S, Moghadam A. (2016). Marchés et nouveaux territoires de l’art dans les villes du Sud. Une introduction, Géographie et cultures, n° 97, p. 5-14.). Ils sont l’un des marqueurs de l’isomorphisme induit par la globalisation du marché de l’art (Velthuis et Curioni, 2015[3]Velthuis O, Curioni S (dir.). (2015). Cosmopolitan canvases: the globalization of markets for contemporary art, Oxford University Press.). De Wynwood à Miami au South Island Cultural District de Hong Kong, de San Telmo à Buenos Aires, à Kala Ghoda à Mumbai, qu’y a-t-il de commun à ces lieux semblant tous faire référence aux mêmes modèles ? L’idée de circulation des modèles urbains substitue à une approche verticale de la normalisation de la fabrique urbaine, une logique horizontale, fondée sur la généralisation des emprunts, des échanges, des imitations et des logiques d’apprentissage collectif (Peyroux, 2016[4]Peyroux, E. (2016). « Circulation des politiques urbaines et internationalisation des villes : la stratégie des relations internationales de Johannesburg », ÉchoGéo, n° 36.). Cette circulation des modèles a été analysée dans l’étude des villes globales, comme le signe de logiques d’homogénéisation, et comme l’hégémonie de modèles urbains dominants (Tait et Jensen, 2007[5]Tait M, Jensen O. (2007). « Travelling ideas, power and place: the cases of urban villages and business improvement districts », International Planning Studies, n° 12(2), p. 107-128.). Cependant, l’émergence du champ des urban policy mobilities a mis l’accent sur l’autonomie des acteurs urbains dans l’appropriation de modèles et le recours à l’inter-référencement (Temenos et McCann, 2012[6]Temenos C, McCann E. (2012). « The local politics of policy mobility: learning, persuasion, and the production of a municipal sustainability fix », Environment and Planning A, n° 44(6), p. 1389-1406.). En effet, aborder la circulation des modèles urbains comme des transferts ne rend pas compte des dynamiques d’inter-référencement qui traversent en permanence les processus de fabrique de la ville (Roy et Ong, 2011[7]Roy A, Ong A. (2011). Worlding cities: Asian experiments and the art of being global, Oxford, John Wiley & Sons.).
L’objectif de cet article est double : expliquer la construction transnationale du modèle du district artistique et analyser l’incorporation du district artistique dans le modèle singapourien. Ce faisant, l’article entend créer un lien entre le débat sur les districts culturels et celui sur la circulation des modèles, afin d’ouvrir un champ de recherche autour de la compréhension des mécanismes de circulation des pratiques, des idées et des références dans le domaine des politiques culturelles urbaines. L’article s’appuie sur une généalogie de l’usage du modèle de district artistique à l’échelle internationale, ainsi que sur une enquête de terrain à Singapour[8]11 entretiens semi-directifs ont été réalisés sur place, avec les principales autorités publiques impliquées dans le projet de cluster de galeries d’art : NAC (Autorité Nationale de la Culture), EDB (Bureau de Développement Économique) ; la principale Foire, Art stage ; 3 employés/propriétaires des galeries Taksu, Faust, Arndt, Kristell Martin ; des institutions artistiques : L’institut d’Art Contemporain, Substation, L’école d’art Lasalle, L’institut Tyler Print et l’association Platform. Nous avons effectué des observations dans les quartiers artistiques et les quartiers de galeries. Ces données de première main ont été complétées par l’analyse de nombreux travaux académiques et de littérature grise sur les stratégies urbaines et culturelles de Singapour, ainsi que par des articles de la presse locale et de la presse artistique internationale..
L’article démontre d’abord que le district artistique est un objet mobile dont la circulation participe à la formation. Il explique ensuite la place de la culture dans le modèle singapourien. Le district artistique des Gillman Barracks constitue à la fois le prolongement logique de ce modèle, mais aussi un lieu où ce modèle se voit questionné et peut-être remis en cause.
La construction du district artistique comme modèle urbain
La littérature académique désigne le district artistique selon des terminologies différentes. Les concepts voisins de « quartier » ou de « cluster » renvoient à des travaux qui abordent la question de la circulation des modèles de manière radicalement opposée. Le quartier artistique est essentiellement conçu comme idiosyncratique, synthétisant la créativité d’une époque, d’une civilisation, d’une nation, d’une ville (While, 2003[9]While A. (2003). « Locating art worlds: London and the making of Young British art », Area, vol. 35, n° 3, p. 251-263., Traversier, 2009[10]Traversier M. (2009). « Le quartier artistique, un objet pour l’histoire urbaine », Histoire urbaine, n° 3, p. 5-20.). À l’opposé, l’expression « cluster culturel » se réfère précisément à l’application à la culture d’un raisonnement et d’un vocabulaire issus de la politique économique et de l’innovation (Mommaas, 2009[11]Mommaas H. (2009). « Spaces of culture and economy: Mapping the cultural-creative cluster landscape », dans Kong L, O’Connor J (dir.), Creative economies, creative cities, Dordrecht, Springer, p. 45-59.). Il fait directement référence à des territoires promus ou qui se promeuvent comme des modèles. La notion de district artistique constitue un entre-deux. Elle peut être tant utilisée pour désigner un territoire caractérisé par la présence artistique que comme un modèle de développement urbain (Chapple et al., 2010[12]Chapple K, Jackson S, Martin A. (2010). « Concentrating creativity: The planning of formal and informal arts districts », City, Culture and Society, n° 1(4), p. 225-234.).
La première dimension d’un district artistique est physique : la concentration dans un territoire donné de lieux, d’acteurs ou d’organisations artistiques. Il peut s’agir d’institutions, de structures commerciales, d’espace de production artistique et d’organisations à but non lucratif. Une deuxième dimension est sociale. La coprésence de ces organisations artistiques génère une masse critique et fait apparaître le territoire comme une destination de visites, de sorties. Leur collaboration donne lieu à l’émergence de projets, d’événements, voire à un mouvement culturel plus vaste. Une troisième dimension est esthétique et repose sur l’interaction entre les acteurs artistiques et l’espace urbain. L’espace peut être incorporé dans les pratiques artistiques comme un matériau symbolique (Grésillon, 2014[13]Grésillon B. (2014). Géographie de l’art : ville et création artistique. Paris, Économica, 254 p.). Réciproquement, les artistes et producteurs culturels interviennent sur l’espace urbain et le façonnent, tantôt de manière matérielle, tantôt de manière performative, en transformant les perceptions du lieu.
En mobilisant l’approche des urban policy mobilities (Baker et Temenos, 2015[14]Baker T, Temenos C. (2015). « Urban policy mobilities research: introduction to a debate », International Journal of Urban and Regional Research, n° 39(4), p. 824-827.), on se demande si le district est un objet circulant. Cette approche invite à aborder la fabrique de la ville de manière connectée. Les politiques urbaines sont non seulement la réponse à un problème local, elles sont aussi le résultat de la circulation transnationale des savoirs urbains, de l’imbrication de réseaux locaux et globaux (Ward, 2006[15]Ward K. (2006). “‘Policies in motion’, urban management and state restructuring: the trans-local expansion of business improvement districts”, International Journal of Urban and Regional Research, n° 30(1), p. 54-75.). Ces travaux explorent donc la tension entre fixité et flux, entre territoires et relations. Certains territoires se construisent à partir d’idées ou d’expériences venues d’ailleurs (Allen et Cochrane, 2007[16]Allen J, Cochrane A. (2007). “Beyond the territorial fix: regional assemblages, politics and power”, Regional Studies, n° 41(9), p. 1161-1175.). Mais en dépit de leur caractère connecté, ces idées sont bien enracinées dans des territoires particuliers : l’émulation, la reconnaissance comme réussite par l’extérieur prend part à la légitimation à l’échelle locale (Gonzalez, 2011[17]Gonzalez S. (2011). “Bilbao and Barcelona ‘in motion’. How regeneration ‘models’ travel and mutate in the global flows of policy tourism”, Urban Studies, n° 48(7), p. 1397-1418.).
L’affirmation et la multiplication de districts artistiques relèvent-elles d’un processus de circulation ? Prenons le cas de SoHo à New York. Ce quartier industriel, qui échappa à la destruction dans les années 1960, fut investi par des artistes puis des galeries, avant de s’imposer dans les années 1970 comme le principal centre de création et de diffusion de l’art new-yorkais, phare du monde de l’art international (Simpson, 1981[18]Simpson C. (1981). SoHo, the Artist in the City, University of Chicago Press.). Si SoHo déclina, victime de son succès, de nombreux districts artistiques émergèrent dans son sillage : Chelsea, toujours à New York, SoWa à Boston mais aussi 798 à Pékin et dans bien d’autres villes à travers le monde. Mais peut-on avec certitude parler de circulation ? Trois types d’explications ont été avancés pour rendre compte de la multiplication des districts artistiques. Une première thèse fait abstraction des logiques de circulation et met l’accent sur la transition généralisée vers un régime d’accumulation postfordiste. Un second argument y voit un processus de « sohoisation », la diffusion d’un modèle urbain hégémonique. Un troisième modèle explicatif voit dans le district artistique une situation relationnelle, un territoire transnational et connecté.
La plupart des observateurs ne considèrent pas la circulation comme un élément significatif et préfèrent pointer un faisceau de facteurs similaires affectant ces différents quartiers. Ils relèvent que ces quartiers qui font face à des processus de désindustrialisation et/ou de gentrification (Smith, 2005[19]Smith N. (2005). The new urban frontier: Gentrification and the revanchist city, Routledge.). Ces dynamiques sont abordées comme le résultat de la transition vers un régime postfordiste, qui entraîne dans un même mouvement le déclin de l’industrie standardisée et de ses territoires industriels, qui se trouvent délaissés, prêts à être alloués à de nouveaux usages (Marcuse, 1997[20]Marcuse P. (1997). « The enclave, the citadel, and the ghetto: What has changed in the post-Fordist US city », Urban affairs review, n° 33(2), p. 228-264.). La montée en puissance de l’économie culturelle (Scott, 1997[21]Scott A. (1997). « The cultural economy of cities », International journal of urban and regional research, n° 21(2), p. 323-339.), ou encore du marché de l’art (Molotch et Treskon, 2009[22]Molotch H, Treskon M. (2009). « Changing art: SoHo, Chelsea and the dynamic geography of galleries in New York City », International Journal of Urban and Regional Research, vol. 33, n° 2, p. 517‐541.) sont les moteurs de ces dynamiques locales et poussent les artistes et acteurs culturels à réinvestir des espaces en friche (Andrés et Grésillon, 2011[23]Andres L, Grésillon B. (2011). « Les figures de la friche dans les villes culturelles et créatives », L’Espace géographique, n° 40(1), p. 15-30.). Cependant, cette approche s’avère insuffisante pour expliquer l’émergence de districts artistiques, qui résulte souvent de la combinaison de facteurs contradictoires (Molho et Sagot-Duvauroux, 2017[24]Molho J, Sagot-Duvauroux D. (2017). « From Global to Local Creative Dynamics: the Location Patterns of Art Galleries », dans Chapain C, Stryjakiewicz T (dir.), Creative Industries in Europe, Springer, Cham, p. 43-64.). Ces dynamiques artistiques investissent souvent des quartiers à la fois marginaux et centraux, à la fois aisés et abordables, accessibles mais enclavés, attirants et repoussants. De plus, si l’émergence de districts artistiques est associée à la désindustrialisation, comment expliquer leur apparition dans des villes où la place de l’industrie reste essentielle, comme à Pékin (Ren et Sun, 2012[25]Ren X, Sun M. (2012). « Artistic urbanization: creative industries and creative control in Beijing », International journal of urban and regional research, vol. 36, n° 3, p. 504-521.), à Mumbai (Ithurbide, 2012[26]Ithurbide C. (2012). Marché de l’art contemporain indien : territoires et réseaux en construction, Transcontinentales. Sociétés, idéologies, système mondial, n° 12/13.) ou encore à Istanbul (Molho, 2014[27]Molho J. (2014). « Territorialisation d’un marché de l’art émergent : le cas d’Istanbul », Belgeo. Revue belge de géographie, n° 3.) ?
Nous sommes donc conduits à un deuxième argument, mettant en jeu un processus de « sohoisation », c’est-à-dire la diffusion d’un modèle urbain hégémonique, conduisant à une homogénéisation des paysages urbains. Comme l’a suggéré Elsa Vivant (2007[28]Vivant E. (2007). « L’instrumentalisation de la culture dans les politiques urbaines : un modèle d’action transposable ? », Espaces et sociétés, n° 4, p. 49-66.), l’instrumentalisation de la culture dans les politiques urbaines s’est imposée comme un « modèle d’action transposable ». En se revendiquant de « l’effet Guggenheim », de nombreux porteurs de projets de musées ont mis en avant les effets en termes de régénération urbaine. L’imaginaire de la « ville créative » ou la « ville récréative » a été sous-jacent dans de nombreuses stratégies urbaines au cours des deux dernières décennies (Peck, 2012[29]Peck J. (2012). “Recreative city: Amsterdam, vehicular ideas and the adaptive spaces of creativity policy”. International Journal of Urban and Regional Research, n° 36(3), p. 462-485.). Cette approche invite à comprendre les processus de gouvernance urbaine à la lumière de l’usage stratégique des modèles extérieurs, utilisés pour légitimer certains intérêts, et promouvoir la marchandisation la ville (Theodore et Peck, 2012[30]Theodore N, Peck J. (2012). “Framing neoliberal urbanism: translating ‘commonsense’ urban policy across the OECD zone”, European Urban and Regional Studies, n° 19(1), p. 20-41.). Conçu d’abord à la lumière d’enjeux de préservation du patrimoine urbain et de création artistique, le district artistique est ainsi devenu un instrument de promotion urbaine. Le modèle de SoHo a ainsi été mobilisé par des développeurs immobiliers afin d’accélérer la valorisation foncière, par exemple à SoWa à Boston. Il a aussi été utilisé par des acteurs du marché de l’art afin de promouvoir l’affirmation d’un nouveau centre, par exemple à Wynwood à Miami, suite à l’installation de la foire Art Basel en 2002. Les pouvoirs urbains autoritaires s’accommodent ainsi parfaitement à ce modèle, en dépit du caractère subversif souvent associé aux milieux artistiques. Ren et Sun (2012[31]Op. cit.) l’ont souligné en suivant les trajectoires des quartiers de galeries de Pékin, tantôt démantelés par la puissance publique ou laissés aux affres de la spéculation immobilière, tantôt stratégiquement maintenus pour promouvoir l’image de la ville à l’occasion des Jeux Olympiques de 2008.
Cependant, l’idée d’homogénéisation semble contradictoire avec l’idée de district artistique, sa valeur résidant précisément dans sa singularité. La standardisation, l’industrialisation sont antinomiques avec le mécanisme de production de la valeur dans l’économie artistique, fondé au contraire sur la construction de la rareté (Moureau et Sagot-Duvauroux, 2016[32]Moureau N, Sagot-Duvauroux D. (2016). Le marché de l’art contemporain, Paris, La Découverte.). De la même manière, l’émulation de modèles de développement urbain par la culture met à mal leur pérennité (Evans, 2003[33]Evans, G. (2003). « Hard‐branding the cultural city–from Prado to Prada », International Journal of Urban and Regional Research, n° 27(2), p. 417-440.). La valeur d’un district artistique relève du registre de l’originalité et de l’authenticité (Zukin, 2009[34]Zukin S. (2009). « Changing landscapes of power: Opulence and the urge for authenticity », International Journal of Urban and Regional Research, n° 33(2), p. 543-553.). Par ailleurs, dans de nombreux cas, les acteurs artistiques s’inscrivent volontairement en dehors des logiques de marché, voire s’efforcent de constituer des espaces de résistance face à la marchandisation de la culture et de la ville (Novy et Colomb, 2013[35]Novy J, Colomb C. (2013). « Struggling for the right to the (creative) city in Berlin and Hamburg: new urban social movements, new ‘spaces of hope’? », International Journal of Urban and Regional Research, n° 37(5), p. 1816-1838.).
Enfin, le district artistique peut être abordé comme un territoire transnational, comme un assemblage (McFarlane, 2011[36]McFarlane C. (2011). Learning the city: knowledge and translocal assemblage, Malden, MA, Blackwell.). La littérature sur les mobilités des politiques urbaines a ouvert de nouvelles perspectives pour la compréhension de la construction d’une action publique urbaine connectée se nourrissant des expériences d’autres territoires (Arab, 2007[37]Arab N. (2007). « À quoi sert l’expérience des autres ? », Espaces et sociétés, n° 4, p. 33-47.). Cette approche, d’une part, prend en compte la demande, le souci de s’inscrire dans un mouvement plus global, d’incorporer des « bonnes pratiques » venues de l’extérieur (Devisme et al., 2007[38]Devisme L, Dumont M, Roy É. (2007). « Le jeu des “bonnes pratiques” dans les opérations urbaines, entre normes et fabrique locale », Espaces et sociétés, n° 4, p. 15-31.). D’autre part, elle adresse l’offre en se penchant sur le rôle des praticiens de l’urbain et sur l’importance de leurs réseaux transnationaux dans la fabrique de la ville (Verdeil, 2005[39]Verdeil É. (2005). « Expertises nomades au Sud. Éclairages sur la circulation des modèles urbains », Géocarrefour. Revue de géographie de Lyon, n° 80(3), p. 165-169.). L’analyse de tels assemblages repose sur l’étude des discours, la circulation des enjeux, des mobilisations, l’analyse multisites. Elle s’intéresse au rôle des individus, des références et questionne la manière dont ces outils en circulation affectent la fabrique du local. Le district artistique constitue une « situation relationnelle » (McCann et Ward, 2011[40]McCann E, Ward E (dir.). (2011). Mobile urbanism: cities and policymaking in the global age, Minneapolis, University of Minnesota Press.), qui découle de la montée en puissance d’un urbanisme fondé sur la connaissance et le transnationalisme. Cet urbanisme transnational est produit par des consultants circulant, des acteurs culturels mobiles, qui sont confrontés à différentes idées dans des lieux divers. Les districts artistiques sont donc plus adéquatement définis comme des territoires transnationaux d’expérimentation, où les champs de l’art et de l’urbain se mêlent, inventant des formes et des esthétiques urbaines.
La culture dans le « modèle singapourien »
De manière récurrente, Singapour a été présentée comme un modèle, un macro-modèle de gouvernance constitué de différentes composantes (Sevin, 2012[41]Sevin O. (2012). « Existe-t-il un modèle singapourien de développement urbain ? », Belgeo. Revue belge de géographie, n° 4.). Depuis son indépendance, en 1965, la cité-État s’est affirmée comme une puissance économique de premier plan. Singapour est l’un des premiers ports mondiaux, la deuxième place financière en Asie. Son PIB par habitant était près de 53 000 $ en 2016. Une littérature abondante a émergé à partir des années 1990 pour mettre en exergue les caractéristiques de cette économie dirigée, où l’État stratège investit systématiquement de nouveaux secteurs de croissance afin d’obtenir un avantage compétitif (Huff, 1995[42]Huff G. (1995). « What is the Singapore model of economic development ? », Cambridge Journal of Economics, n° 19(6), p. 735-759.). Sa politique de logement, souvent citée en exemple, est parvenue à fournir à la majorité des citoyens l’accès à des logements de qualité, malgré la rareté des ressources foncières (Phang, 2007[43]Phang SY. (2007). « The Singapore model of housing and the welfare state », dans Groves R, Murie A, Watson C (dir.), Housing and the New Welfare State: Perspectives from East Asia and Europe, Ashgate, p. 15-44.). La généralisation de l’accès aux transports en commun associée à des péages urbains dynamiques a contribué à voir Singapour reconnue comme un modèle de « ville intelligente » (Goh, 2002[44]Goh M. (2002). « Congestion management and electronic road pricing in Singapore », Journal of Transport Geography, n° 10(1), p. 29-38.).
Pour Gavin Shatkin (2014[45]Shatkin G. (2014). « Reinterpreting the meaning of the “Singapore Model”: state capitalism and urban planning », International Journal of Urban and Regional Research, n° 38(1), p. 116-137.) l’aménagement urbain est au cœur du modèle singapourien puisqu’il permet à l’État de s’imposer comme le principal acteur économique et d’utiliser le marché foncier afin d’emporter des gains politiques et financiers[46]Shatkin évalue que les revenus de l’opération Marina Bay Sands a généré en tout un revenu de 36 milliards de dollars singapouriens entre 2006 et 2008, correspondant à plus de 20 % du budget national de la cité-État sur cette période.. Les transferts internationaux ont un rôle clé dans la perpétuation de ce modèle. En s’inspirant constamment d’exemples étrangers et en s’adjoignant fréquemment de l’expertise extérieure, le pouvoir Singapourien conforte une légitimité qu’il conçoit comme fondée sur son efficacité (Nasir et Turner, 2013[47]Nasir KM, Turner B. (2013). « Governing as gardening: reflections on soft authoritarianism in Singapore », Citizenship Studies, n° 17(3-4), p. 339-352.). En 1963, Charles Abrams, Susumi Kobe et Otto Koenigsberger coordonnèrent un rapport dans le cadre des Nations Unies. À l’approche régulationniste qui avait prévalue à l’époque coloniale, ils recommandèrent une logique fondée sur un État développementaliste, qui fut adoptée par le gouvernement singapourien à partir de l’indépendance en 1965 (Dale, 1999–[48]Dale OJ. (1999). Urban planning in Singapore: The transformation of a city, Oxford University Press.).
Par ailleurs, l’exportation du modèle singapourien est également essentielle dans sa légitimation. De multiples expériences en Asie se réfèrent à Singapour (Marshall, 2003[49]Marshall R. (2003). Emerging urbanity: global urban projects in the Asia Pacific Rim, London, Spon Press.). Le gouvernement singapourien ne cesse de promouvoir son modèle à l’international, par exemple, à travers l’organisation d’un sommet annuel mondial sur les villes intelligentes, rassemblant les dirigeants et maires du monde entier. Des firmes d’État comme Keppel Land et CapitaLand font la promotion du modèle singapourien en effectuant des investissements immobiliers dans le monde entier. Surbana, une émanation de l’autorité du logement de Singapour créée en 2003, réalise des missions de consultance et de design urbain dans plus d’une vingtaine de pays à travers le monde. Ainsi, le modèle singapourien constitue un assemblage complexe d’éléments différenciés, s’ajustant en fonction des intérêts et des acteurs qui le mobilisent (Pow, 2014[50]Pow CP. (2014). « License to travel: Policy assemblage and the “Singapore model” ». City, n° 18(3), p. 287-306.).
Afin de comprendre l’incorporation du district artistique dans le modèle singapourien, il convient d’expliquer l’évolution de la place qu’y tient la culture. Tout d’abord, à l’aube de son indépendance, la cité-État l’aborde au prisme de la question de la gestion de la diversité culturelle. Suite à la crise économique de 1985, le gouvernement de Singapour commence à percevoir la culture comme un facteur de développement. À partir de la crise de 2008, il la reconnaît comme un secteur économique à part entière.
Au cours de la première étape, qui émerge dans les années 1950 suite à la décolonisation, la culture est abordée comme un problème public, et la politique culturelle comme une ingénierie politico-sociale. Pour survivre, l’État singapourien naissant doit assurer la coexistence pacifique d’ethnies diverses, éviter la désintégration, se protéger des influences extérieures, des pays musulmans voisins sur la minorité malaise, de la Chine communiste sur la majorité chinoise (Tan, 2003[51]Tan E. (2003). « Re-engaging Chineseness: Political, economic and cultural imperatives of nation-building in Singapore », The China Quarterly, n° 175, p. 751-774. ; Mutalib, 2012[52]Mutalib H. (2012). Singapore Malays: being ethnic minority and Muslim in a global city-state, Routledge.). Après l’indépendance de Singapour, les lois de citoyenneté et d’immigration ont réduit la part de la population non résidente à moins de 3 % (Yeoh et Lin, 2012[53]Yeoh B, Lin W. (2012). « Rapid Growth in Singapore’s Immigrant Population Brings Policy Challenges », The Online Journal of the Migration Policy Institute [En ligne). La cité-État souhaitait consolider le sentiment national au sein d’une société très diverse, composée de trois principaux groupes ethniques : les Chinois (74 %), les Malais (13 %) et les Indiens (9 %). Singapour reconnaît ces différentes communautés sur un pied d’égalité. L’État a quatre langues officielles : l’anglais, le malais, le chinois mandarin et le tamoul. À travers différentes politiques publiques, le gouvernement s’est efforcé de créer un sentiment d’identité locale, au-delà des distinctions ethniques (Yeoh et Chang, 2001[54]Yeoh B, Chang TC. (2001). « Globalising Singapore: debating transnational flows in the city », Urban Studies, n° 38(7), p. 1025-1044.).
Comme le montre Henderson (2005[55]Henderson J. (2005). « Planning, Changing Landscapes and Tourism in Singapore », Journal of Sustainable Tourism, n° 13, p. 2.), dans l’approche développementaliste que ce « tigre asiatique » met en place suite à son indépendance, la préservation des cultures vernaculaires est délaissée au profit de la planification de zones économiques et d’un développement industriel effréné. La politique culturelle, quant à elle, vise à favoriser des relations harmonieuses entre les différentes ethnies qu’abrite la cité-État (Bereson, 2003[56]Bereson R. (2003). “Renaissance or regurgitation? Arts policy in Singapore 1957-2003”, Asia Pacific Journal of Arts and Cultural Management, n° 1(1), p. 1-14.). Dès 1959, le rapport annuel de l’État de Singapour énonce deux objectifs : « La création d’un sentiment d’identité nationale. L’élimination des divisions et des attitudes communautaires » (State of Singapore, 1959[57]State of Singapore. (1959). State of Singapore Annual Report, Singapour, Government Printing Office of Singapore.). En 1978, une division des affaires culturelles est créée afin de promouvoir la culture des différents groupes ethniques, promouvoir l’art pour tous et créer des centres culturels de quartiers (Lee, 2003[58]Lee WK. (2003). « Creating a “city of art”: evaluating Singapore’s vision of becoming a renaissance city », thèse de doctorat, Massachusetts Institute of Technology.). Par ailleurs, les programmes de l’autorité du logement (HDB), qui abritent les trois quarts de la population dans des appartements loués pour 99 ans, s’attachent à répartir les différentes ethnies de manière homogène (Rodan et Jayasuriya, 2009[59]Rodan G, Jayasuriya K. (2009). « Capitalist development, regime transitions and new forms of authoritarianism in Asia », The Pacific Review, n° 22(1), p. 23-47.).
En 1985, Singapour traverse une crise économique qui la pousse à chercher un nouveau modèle de croissance (Kong, 2000[60]Kong L. (2000). “Cultural policy in Singapore: negotiating economic and socio-cultural agendas”, Geoforum, n° 31(4), p. 409-424.). En 1986, elle lance le plan de développement d’un produit touristique et consacre un milliard de dollars singapouriens[61]Un dollar singapourien équivaut à 0,67 euro. à la protection d’espaces naturels et à la réhabilitation de quartiers « ethniques », comme Chinatown et Little India, afin de « tirer profit des atouts naturels ainsi que de l’identité et de l’histoire locale » (Henderson, 2005–[62]Op. cit.). En 1988, le Conseil d’orientation sur l’art et la culture présente la culture comme un facteur de développement économique, et la politique culturelle comme un instrument de marketing territorial : « De bons équipements et activités nous aideront à attirer des spectacles et des expositions de niveau international, créant ainsi un environnement plus propice pour que les investisseurs et les professionnels restent et que les touristes visitent Singapour » (ACCA, 1989[63]ACCA (Advisory Council on Cultural and the Arts). (1989) Report of the Advisory Council on Culture and the Arts, Singapour.). En 1990, l’administration de la culture est reconfigurée : la gestion des relations interethniques est attribuée au ministère du Développement communautaire (Community development), et un ministère de l’Information et des Arts (MITA) est créé. Deux autorités sont établies : en 1991, le Conseil national des arts (NAC) et, en 1993, le Bureau national du patrimoine (NHB). Cette institutionnalisation passe aussi par la construction d’infrastructures. Le plan d’hébergement des arts (Arts housing scheme) vise à créer des espaces pour les artistes et 26 nouveaux centres d’arts. Dans le Civic District, d’anciennes écoles sont converties en musées. En 1996, l’institut Saint-Joseph est réhabilité et accueille le musée d’Art de Singapour. L’année suivante, le musée des Civilisations asiatiques est établi dans l’ancien bâtiment de l’école Tao Nan.
Pour défendre ces investissements, le ministre de la Culture, Georges Yeo, les présente comme un « impératif darwinien ». Ils doivent assurer la survie de la cité-État de Singapour dans un univers concurrentiel : « Nous devrions voir les arts non comme un luxe ou comme une simple consommation, mais comme un investissement dans le peuple et l’environnement. Nous avons besoin d’un fort développement des arts pour contribuer à faire de Singapour une des principales villes hub du monde. Nous avons aussi besoin des arts pour nous aider à produire des biens et des services qui soient compétitifs sur le marché mondial. » (Yeo, 1991, p. 54[64]Op. cit.). En mars 2000, le Plan de renaissance culturelle marque le lancement d’une série de programmes mettant la culture au centre du développement de Singapour : « Construire un buzz culturel et créatif nous aidera donc à attirer des talents locaux et étrangers pour contribuer au dynamisme et à la croissance de notre économie et de notre société » (MITA, 2000, p. 5[65]Ministry for Information and the Arts (MITA) (2000) The Renaissance City Report: Culture and the arts in renaissance Singapore, MITA, Singapour.). Ce plan soutient l’organisation d’événements culturels internationaux, comme le festival d’art ou le festival des écrivains, ainsi que le développement de 7 000 m2 d’infrastructures culturelles.
La création de quartiers culturels émerge ainsi progressivement, sous l’impulsion de l’Autorité de redéveloppement urbain (URA) : « L’URA a identifié certaines zones à Singapour où il y a une concentration d’activités et les circonscriptions qui sont attractives et que l’on peut encourager davantage[66]Entretien avec une responsable de NAC [E1]. ». Les quartiers centraux, qui concentrent la plupart des lieux culturels, tels que le Civic District, et Bras Basah Bugis sont particulièrement ciblés. Cette stratégie mobilise, d’une part, les autorités culturelles évoquées plus haut, NAC et NHB, ainsi que l’office de tourisme (Singapour Tourism Board, STB), qui collaborent dans l’animation et la promotion de ces territoires.
Un nouveau tournant intervient au cours des années 2000 et tout particulièrement après la crise financière de 2008. La culture est désormais perçue comme nouveau segment de croissance. De fait, au cours des années 2000, le secteur des arts visuels singapourien connaît un fort développement. Le nombre d’entreprises dans le secteur des arts visuels a augmenté de 153 en 2003 à 464 en 2012, et les associations de 47 à 58 (MCCY, 2013[67]Ministry of Culture, Community and Youth (MCCY) (2013) Singapore Cultural Statistics, MCCY, Singapour). Dans la même période, le nombre d’expositions est passé de 535 à 675. Entre 2003 et 2011, les revenus des arts visuels passent de 2,6 à 3,3 milliards de dollars singapouriens. De plus, Singapour s’engage dans une compétition pour le leadership culturel en Asie, qui la pousse à scruter les actions de ses concurrents : « Avec l’affluence et la puissance économique croissante de l’Asie, beaucoup de villes asiatiques vont consacrer des investissements importants dans l’art et la culture, et en faire une partie intégrante du développement et du positionnement national. Les développements culturels de haut niveau comprennent la “Vision 2015 : Séoul Ville Culturelle”, le quartier culturel de West Kowloon à Hong Kong, le quartier culturel de l’île Saadiyat à Abu Dhabi, et la prolifération d’institutions de classes mondiales dans les villes chinoises de premier plan comme Pékin et Shanghai, de même que des villes émergentes comme Guangzhou » (MCCY, 2012[68]Minister of Culture Community and Youth (MCCY). (2012). The report of the arts and culture strategic review [En ligne). Singapour n’est pas en reste, avec l’inauguration, en 2015, de la Galerie Nationale, un musée de 64 000 m2 dédié à l’art de Singapour et de l’Asie du Sud-Est, établi dans les anciens bâtiments de la Cour suprême et de la municipalité, grâce à un investissement de 532 millions de dollars singapouriens.
Afin de prendre part à cette stratégie, le Bureau de développement économique (EDB), bras armé de la stratégie du développement de Singapour, a mis en place, en 2008, un nouveau département consacré au « style de vie »: « EDB était concentré sur l’industrie et le secteur manufacturier. Si nous avons gardé ce cœur d’activité, l’État recherche d’autres domaines à travers lesquels l’économie peut croître. Dans le bureau du programme Lifestyle, nous avons quatre subdivisions : les arts visuels, la musique (avec des entreprises comme Sony music), le sport (avec Puma, Adidas) et le design. Nous voulions créer de plus en plus d’emplois diversifiés pour les Singapouriens[69]Entretien avec une responsable d’EDB [E2]. ». Le ministère de l’Économie a mis en place des mesures fiscales pour attirer les entreprises artistiques, en particulier les galeries et les antiquaires qui disposent d’un statut particulier. Les nouvelles organisations artistiques ont un statut pionnier, ce qui leur permet d’être exemptées d’impôts pendant cinq à dix ans. Les acheteurs qui ne sont pas résidents bénéficient d’une exemption de l’impôt sur les biens et services (Lee, 2003[70]Op. cit.).
Selon Gavin Shatkin (2014[71]Op. cit.), le modèle singapourien « a transformé la nation essentiellement en un seul et même mégaprojet massif, comprenant des villes nouvelles de logements publics, éparpillées comme des perles autour de l’île de la cité-État, un centre d’affaires planifié et conçu méticuleusement et des quartiers historiques transformés dans leur ensemble en simulacres touristiques ». L’État singapourien se manifeste par un esprit de conquête foncière, par lequel il s’efforce d’insérer chaque parcelle de son territoire dans un imaginaire commun. Cet imaginaire, qui se nourrit abondamment de références étrangères, sert à construire un modèle exportable. Cet aperçu chronologique de l’évolution progressive de la place de la culture dans le modèle singapourien, soulignant le passage d’une logique de gestion de la diversité culturelle à une approche de la culture comme un secteur économique, permet non seulement d’éclairer le recours au district artistique, il montre que la fabrique du modèle singapourien ne relève pas d’une trajectoire linéaire, ni d’un simple transfert international, mais d’un processus progressif d’essais et d’erreurs. Ce processus est affecté par des facteurs locaux, tels que des crises économiques, des inflexions politiques conjoncturelles, mais il reflète aussi l’inscription de la cité-État dans des réseaux transnationaux d’idées et de pratiques de politiques urbaines.
Aux marges du modèle : le district artistique des Gillman Barracks
Les Gillman Barracks sont au cœur de l’ambition de Singapour de se poser en centre culturel régional. L’idée de concevoir dans ce site un cluster de galeries d’art provient du Bureau de développement économique (EDB). Son principal objectif était d’attirer des galeries de niveau international, afin de diversifier une scène constituée jusqu’ici principalement de galeries à horizon local, et de faire de la cité-État un lieu incontournable à l’échelle régionale. Pour ce faire, le district artistique avait vocation à créer un effet de masse critique, afin de faire bénéficier aux visiteurs d’une diversité de types et de styles artistiques, et de permettre aux galeries d’interagir : « En 2008, l’intérêt pour l’art de l’Asie du Sud-Est a commencé à croître, avec la création de richesses en Indonésie et aux Philippines. Donc on cherchait des galeries avec un intérêt pour venir explorer ces nouveaux marchés » [E2].
Ce projet doit beaucoup au parcours et à la personnalité des deux pères du projet : Beh Swan Gin et Eugene Tan. Beh Swan Gin était alors le directeur général d’EDB. Ce docteur en médecine, diplômé en management de Stanford et de Harvard, avait auparavant été en charge du cluster biomédical de Singapour. C’est sur la base de cette expérience que l’idée d’appliquer le modèle du cluster[72]Ce modèle a été théorisé par le professeur en management de l’université d’Harvard, Michael Porter. au marché de l’art a pu émerger. De surcroît, EDB s’adjoint l’appui de Eugene Tan. Cette figure majeure du monde de l’art singapourien fut rapatriée de Hong Kong afin de diriger le projet des Gillman Barracks et de le promouvoir auprès des acteurs du marché de l’art international : « Dr Eugene Tan voyageait autour du monde auprès de différentes galeries pour leur faire comprendre l’intérêt du marché asiatique. À ce moment, le marché était jeune… Donc il est allé en Chine, en Europe et a parlé à beaucoup de galeries différentes » [E2].
Quand l’idée d’un cluster de galeries a émergé, EDB ne disposait pas de site. L’URA s’est donc chargée de faire des propositions de lieux pouvant se prêter à un tel projet. La principale proposition concurrente fut un bâtiment industriel, à Waterloo, une zone centrale disposant déjà d’activités artistiques, avec la Waterloo Arts Belt. Mais ce sont finalement les casernes de Gillman qui sont choisies : « Eugene Tan est allé regarder les espaces et les a comparés. Ils ont pensé que Gillman serait plus percutant, parce que c’est un site historique avec tous ses bâtiments coloniaux. Et aussi parce que la combinaison entre l’espace naturel, l’art et l’histoire le rendait attirant pour les visiteurs » [E2].
Les Gillman Barracks (ou casernes Gillman) sont sur un site de 6,4 hectares (figure 1). Ces casernes ont été construites en 1936 pour accueillir un bataillon de près de 700 soldats de l’armée britannique. Le lieu comportait un centre de formation et divers équipements : une piscine, un terrain de badminton, une salle de cinéma. La localisation du site sur le flanc de la colline Telok Blangah visait à le protéger de potentiels assaillants venant depuis la mer. Les 14 bâtiments furent cédés aux forces armées de Singapour en 1971, à la suite du retrait des troupes britanniques.

Figure 1. Carte de localisation des Gillman Barracks (carte réalisée par l’auteur).
Dans les années 1990, les forces armées quittent le site, qui fut rebaptisé Gillman Village, en 1996, et accueillit des commerces. En 2010, l’opération de réhabilitation fut lancée, et le site retrouva son titre des « casernes de Gillman », évoquant son patrimoine militaire. Grâce à un investissement de 10 millions de dollars singapouriens, le gouvernement singapourien inaugure, en 2012, un site disposant de 4 200 m2 pour les galeries d’art et de 4 800 m2 pour des organisations artistiques à but non lucratif et des ateliers d’artistes. En 2013, l’université technologique de Nanyang y ouvre un centre d’art contemporain, le CCA, qui emploie 18 personnes et organise des expositions, des résidences d’artistes et des programmes de recherche et d’éducation sur l’art contemporain. Le site accueillera 17 galeries à son apogée, en 2015.
Bien que connecté par les transports en commun, le métro et le bus, le site est néanmoins en dehors des sentiers battus, les lieux de récréation étant habituellement plus proches du centre-ville. Les Gillman Barracks se trouvent dans un environnement urbain disparate comprenant des ensembles de bureaux, des logements collectifs, des lotissements de villas de luxe, ainsi que trois grands parcs (figure 2). Le site donne l’impression d’une sorte de parc d’attraction dédié à l’art contemporain (figure 5). Le parcours est clairement pensé : un chemin couvert protège les visiteurs du soleil ou de la pluie. Des cartes de localisation et des panneaux parsèment le site pour guider les visiteurs vers les différents bâtiments qui abritent les galeries (figures 3 et 4).

Figure 2. Représentation des Gillman Barracks dans la maquette de la City Gallery de Singapour (cliché : auteur).

Figure 3. Le bâtiment 9 (cliché : auteur).

Figure 4. L’intérieur de la galerie Pearl Lam (cliché : auteur).
Les Gillman Barracks sont inaugurées le 15 septembre 2012 en fanfare, promues comme la « destination en vogue de l’art contemporain en Asie[73]Communiqué de presse : Singapore, 14 September 2012, NTU to drive Singapore’s new contemporary art centre at Gillman Barracks [En ligne ». Elles font l’objet d’une importante couverture médiatique, de la part de la presse locale (Straits Times), internationale (Japan Times), mais aussi de la part de la presse artistique (ArtAsiaPacific). Le recours à des références étrangères pour décrire le projet est récurrent : il est présenté comme la « tentative de Singapour pour construire un district artistique similaire au 798 de Pékin, au village artistique de Heyri en Corée du Sud et à Chelsea à New York » (Shetty, 2015[74]Shetty D. (2015). « Nearly a third of Gillman Barracks galleries have decided not to renew their leases », Straits Times, 11 avril [En ligne). En juin de l’année suivante, la chaîne Channel News Asia diffuse un documentaire intitulé « Singapour : la nouvelle capitale des arts », qui détaille le projet des Gillman Barracks.

Figure 5. Photographie de la carte de situation du site des Gillman Barracks (cliché : auteur).
Le recours à des expériences extérieures alimente le projet: « On fait aussi nos propres recherches sur des quartiers artistiques à travers le monde, ce qu’ils font, ce qui marche pour eux » [E2]. La démarche d’EDB se distingue du transfert : ils analysent les conditions spécifiques des exemples étrangers afin d’emprunter éventuellement certaines idées en les adaptant à la situation de Singapour. Cette démarche repose largement sur le savoir des acteurs culturels partenaires du projet et de Eugène Tan : « Ils sont capables de nous donner leur analyse, parce qu’ils connaissent la scène singapourienne, et ils regardent aussi tous ces quartiers artistiques extérieurs » [E2]. À l’inverse, certains districts artistiques sont abordés comme des contre-modèles pour réfléchir au développement du projet de Gillman Barracks : « 798, à Pékin, est né de façon organique. Mais ce que l’on voit, c’est que toutes les organisations artistiques ont dû partir à cause de la montée des loyers. Ici, nous avons essayé d’avoir quelque chose d’abordable. Une des raisons pour lesquelles on ne veut pas que le projet dans son ensemble soit alloué à un développeur privé est que nous ne serions alors pas capables de contrôler les loyers » [E2].
Gillman Barracks représente une plate-forme d’internationalisation des scènes artistiques régionales : « La plupart des galeries des casernes de Gillman sont des galeries internationales avec une branche à Singapour : Tagore, Janssen, Arndt, Mizuma, Pearl Lam, Shangart. Si vous allez voir des artistes indonésiens et vous leur dîtes : viens avec moi et je t’ouvrirai une exposition à Singapour et aussi à New York ou à Hong Kong, bien sûr que l’artiste sera content[75]Entretien avec un responsable de la principale foire de Singapore, Art Stage [E3]. ». En retour, les galeristes sont en mesure de se poser en passeurs, en découvreurs de talents locaux, auprès de leurs marchés originaux, à l’instar de Sundaram Tagore, galeriste new yorkais qui présente son installation à Singapore comme une démarche intellectuelle et esthétique en lien avec son positionnement de pont entre l’Orient et l’Occident : « Je voulais rassembler une communauté globale d’artistes avec une base d’échange interculturel » (Tagore, 2013[76]Tagore S. (2013). « What will make Singapore a world arts hub », The Malaysian Insider, 18 mars [En ligne). La proximité de nombreuses galeries importantes constitue indéniablement un atout : « L’avantage principal des casernes de Gillman est bien sûr le fait d’être proches d’autres galeries, parce que ça attire un public de qualité. Pas seulement des gens qui veulent acheter de l’art, mais des gens qui sont intéressés par l’art et avec qui vous pouvez parler d’art[77]Entretien avec une employée de la galerie Faust [E4]. ». Cet environnement constitue un lieu de discussion, grâce à l’organisation de conférences d’artistes, de performances et autres projets artistiques.
Cependant, les galeries émettent certaines critiques quant au projet. JTC, l’organisation en charge de l’aménagement du lieu, s’occupe habituellement de sites industriels et peine à répondre aux exigences de qualité des galeries. Des sols qui craquent au faible nombre de toilettes, en passant par l’absence de chemin protégé de la pluie jusqu’à la fin de l’année 2014, JTC a suscité l’irritation de plusieurs galeries. Une autre critique concerne la stratégie de marketing d’EDB. Le positionnement haut de gamme des services proposés rend le site peu attractif : « Si on veut attirer un plus grand public, ils ne vont pas venir s’il n’y a rien à boire, et si le déjeuner est à 30$[78]Entretien avec une responsable de la galerie Arndt [E5]. ». Plus généralement, le manque de connaissance d’EDB vis-à-vis des codes du monde de l’art est pointé. Une responsable de la galerie Arndt cite l’exemple d’un document de promotion omettant de mentionner la présence du CCA, qui est pourtant l’institution culturelle phare des Casernes de Gillman, susceptible d’attirer les amateurs d’art.
Si le lieu fournit une expérience de découverte, il contraint le visiteur à marcher entre des lieux relativement espacés, dans une atmosphère tropicale. De surcroît, la population se montre peu réceptive. Une employée de la galerie Faust relate qu’au cours de la première année, il y avait moins de 10 visiteurs par jour. Certains jours, personne n’entrait dans la galerie. Après deux ans et demi, le nombre de visiteurs se limitait à une moyenne de 30 pour les jours de la semaine et 50 le weekend. D’après un sondage réalisé par le CCA, 50 % de ces visiteurs appartiennent au monde de l’art (artistes, critiques, curateurs) (Yusof, 2016a[79]Yusof H. (2016a). « Has Gillman Barracks turned the corner? », Business Times, 24 juin [En ligne). Enfin, bien que les loyers proposés soient préférentiels, ils demeurent élevés (plus de 23 euros au m2 par mois[80]Pour une surface de 320 m2, Arndt devait payer, en 2015, 11 500 dollars singapouriens (soit environ 7 500 euros) par mois.).
Aux alentours de 2015-2016, les Gillman Barracks connaissent une crise. En avril 2015, cinq galeries décident de ne pas renouveler leur bail (Shetty, 2015[81]Op. cit.). Deux galeries supplémentaires quittent le site en 2016, mettant en cause des ventes insuffisantes et un faible nombre de visiteurs. Si les plus grandes galeries parviennent à tenir bon, ce sont les jeunes galeries qui font les frais de ce mauvais départ. En 2016, le NAC met en place le bureau du programme des Gillman Barracks, afin de toucher un public plus large. Son directeur, Low Eng Teong, affirme vouloir faire évoluer la programmation du lieu pour « offrir différents types d’expériences aux visiteurs, et aider Gillman à s’intégrer plus largement dans la scène artistique de Singapour » (Yusof, 2016b[82]Yusof H. (2016b). « Gillman redefines role at its four-year mark », Business Times, 16 septembre [En ligne). Le profil des nouveaux venus marque une volonté de diversification. Le site accueille Playeum, un centre de créativité pour les enfants, Art Outreach, une association d’éducation artistique, Superama, un magasin de design, ainsi que de nouveaux lieux de restauration. Low Eng Teong défend ce choix : « nous ne voyons pas notre rôle seulement comme celui de vendre de l’art, mais plutôt comme celui de présenter l’art et de contribuer à un discours sur l’art[83]Ibid. ». Afin de diversifier le public, NAC cherche à s’adresser aux familles en proposant des activités pour les enfants, aux jeunes, en utilisant les réseaux sociaux et en organisant des soirées électro ou des barbecues.
Si le projet des Gillman Barracks peine à se poser comme la déclinaison du modèle singapourien dans le domaine culturel, il n’en constitue pas moins un espace transnational où l’inter-référencement est omniprésent. Celui-ci est d’abord d’ordre purement artistique. Le jour de l’ouverture des Gillman Barracks, une discussion sur Marcel Duchamp en Indonésie est organisée avec Arahmaiani Indieguerillas et Filippo Sciascia, sur la base d’une exposition d’Equator Art Project. Nombreux sont les exemples d’expositions d’artistes célèbres présentés comme leurs premières dans la région. Ainsi, en mai 2013, Michael Janssen organise la première exposition de Peter Zimmerman dans la région, puis en août 2013, celle de Ai Weiwei.
Les casernes de Gillman sont aussi un lieu d’expérimentation où des nouveaux rapports à l’art et de nouvelles spatialités sont mises à l’épreuve. Le collectif artistique Post museum a ainsi investi le lieu d’un camp urbain ouvert 24h/24 afin de trouver des « idées pour la ville qui peuvent permettre de former un meilleur futur pour chacun », comme l’indique Woon Tien Wei (Devi, 2017[84]Devi R. (2017). « A camp with a difference », TODAYonline, 21 janvier [En ligne). Les casernes de Gillman constituent un lieu où des expériences critiques peuvent être réalisées. En 2015, l’exposition de Gilbert et George organisée par la galerie Arndt constitue une critique de la société de surveillance. Les 26 photomontages exposés comportent des messages ironiques tels que : « No Urinating, CCTV in Operation » qui « trouvent une résonnance particulière à Singapour » [E5], où cracher est passible d’une amende de 200 euros. De même, l’œuvre d’art urbain de Mary Lee (figure 6), réalisée sur les murs d’une galerie à l’occasion du projet Drive, intitulée Institutionalised Pressure, critique explicitement le régime de la cité-État : l’œuvre « traite des mécanismes de contrôle, de régulation et de pression de la ville de Singapour, qui célèbre la méritocratie et favorise un environnement de conformité, d’homogénéité et de routine. Cette course de souris est une source de malheurs pour la plupart, en particulier pour les plus défavorisés[85]Prospectus de présentation des œuvres du projet Drive, retrouvé sur la page Facebook des Gillman Barracks, publié en décembre 2014 [En ligne ».

Figure 6. Peinture murale de Mary Lee, Institutionalised Pressure (cliché : auteur).
La trajectoire des Gillman Barracks est très éloignée du caractère linéaire associé à la notion de transfert international de modèles. Ouverts et nourris de références étrangères, les porteurs du projet se sont néanmoins adaptés de manière pragmatique aux contraintes et aux aléas du territoire. À la peine pour imposer un modèle exportable, ils ont néanmoins suscité la formation d’un territoire transnational, où interagissent artistes, galeristes, curateurs, associations, d’horizons divers, de cultures diverses. Aux marges du modèle singapourien, la mobilité des idées, des œuvres, des personnes, dans ce territoire transnational, alimente expérimentations et questionnements.
Conclusion
Cette exploration de la circulation du modèle du district artistique à Singapour nous a conduit à rencontrer deux usages du vocable « modèle » qu’il convient de distinguer. Il y avait d’abord ce que l’on a appelé le « modèle singapourien », synonyme d’exemple à suivre, un macro-modèle transectoriel qui embrasse la ville dans son ensemble. Il s’agit d’un modèle prescriptif, fondé sur des transferts, sur l’importation et l’exportation d’idées urbaines. Cela correspond à ce que Roy et Ong (2011[86]Op. cit.) appellent le « modelage » : l’enjeu pour Singapour est de « faire modèle », afin de se légitimer. Mais nous avons également traité du modèle de district artistique, un modèle micro, synonyme de référence, qui se réfère à une portion de territoire, à un secteur particulier. Nous avons montré qu’il s’était diffusé par émulation, son évocation dans d’autres territoires servant de symbole légitimant. C’est là un modèle fondé sur la circulation transnationale, les emprunts mutuels, ce que Ong appelle « l’inter-référencement ».
Ces processus macro et micro sont le plus souvent distingués. Ils renvoient à des champs distincts de l’analyse des mobilités des politiques urbaines (Temenos et McCann, 2012[87]Op. cit.) : d’un côté, l’imposition de modèles hégémoniques, de l’autre, la formation d’assemblages translocaux. Cet article suggère que l’on peut dépasser l’opposition entre ces deux manières d’aborder la circulation des modèles urbains. Le modèle singapourien ne se réduit pas à un monolithe, même s’il est vendu comme tel par ses porteurs, il se constitue d’assemblages différenciés. Il se nourrit d’une multitude de micro-modèles sectoriels ou localisés, qui participent de la construction de Singapour comme un modèle.
Au fil des décennies, la culture a pris une place croissante dans le modèle singapourien, d’abord abordée comme ingénierie sociale, puis comme facteur de développement, et enfin comme secteur économique. La construction du district artistique des Gillman Barracks apparaît donc comme l’aboutissement, le prolongement du modèle singapourien. Cependant, s’il ne fait aucun doute que Singapour a été reconnue comme un modèle dans des domaines aussi variés que la politique du logement, du développement économique, des transports, sa politique culturelle semble échouer à faire modèle. Bien que fortement promus à leur inauguration, les Gillman Barracks n’ont pas résisté à l’épreuve du temps, et n’ont pas su attirer le même engouement que des districts artistiques spontanés tels que le 798 de Pékin. Cependant, la valeur de ce projet n’est peut-être pas à rechercher dans les objectifs initialement annoncés – faire de Singapour un centre du marché de l’art global – mais plutôt dans les effets imprévus générés par l’existence de cette enclave culturelle. Elle réside davantage dans les possibilités d’expérimentations culturelles et sociales que le site a ouvertes, et l’émergence tangible d’un espace civique. Sa valeur réside précisément dans sa faculté à pointer les limites du modèle singapourien. La crise de 2015-2016, aboutissant au transfert de l’autorité du projet des acteurs économiques aux acteurs culturels, consacre le constat que la culture ne saurait être conçue uniquement au prisme de l’économie et du marché. Ainsi, aux marges du modèle singapourien, émerge un « espace de l’espoir » (Harvey, 2000[88]Harvey D. (2000). Spaces of hope, University of California Press.), où ce modèle peut être dépassé, nourri des utopies et des expérimentations de multiples ailleurs.
[1] Chua BH. (2011). “Singapore as model”, dans Roy A, Ong A (eds.), Worlding cities: Asian experiments and the art of being global, Oxford, Wiley-Blackwell.
[2] Brones S, Moghadam A. (2016). Marchés et nouveaux territoires de l’art dans les villes du Sud. Une introduction, Géographie et cultures, n° 97, p. 5-14.
[3] Velthuis O, Curioni S (dir.). (2015). Cosmopolitan canvases: the globalization of markets for contemporary art, Oxford University Press.
[4] Peyroux, E. (2016). « Circulation des politiques urbaines et internationalisation des villes : la stratégie des relations internationales de Johannesburg », ÉchoGéo, n° 36.
[5] Tait M, Jensen O. (2007). « Travelling ideas, power and place: the cases of urban villages and business improvement districts », International Planning Studies, n° 12(2), p. 107-128.
[6] Temenos C, McCann E. (2012). « The local politics of policy mobility: learning, persuasion, and the production of a municipal sustainability fix », Environment and Planning A, n° 44(6), p. 1389-1406.
[7] Roy A, Ong A. (2011). Worlding cities: Asian experiments and the art of being global, Oxford, John Wiley & Sons.
[8] 11 entretiens semi-directifs ont été réalisés sur place, avec les principales autorités publiques impliquées dans le projet de cluster de galeries d’art : NAC (Autorité Nationale de la Culture), EDB (Bureau de Développement Économique) ; la principale Foire, Art stage ; 3 employés/propriétaires des galeries Taksu, Faust, Arndt, Kristell Martin ; des institutions artistiques : L’institut d’Art Contemporain, Substation, L’école d’art Lasalle, L’institut Tyler Print et l’association Platform. Nous avons effectué des observations dans les quartiers artistiques et les quartiers de galeries. Ces données de première main ont été complétées par l’analyse de nombreux travaux académiques et de littérature grise sur les stratégies urbaines et culturelles de Singapour, ainsi que par des articles de la presse locale et de la presse artistique internationale.
[9] While A. (2003). « Locating art worlds: London and the making of Young British art », Area, vol. 35, n° 3, p. 251-263.
[10] Traversier M. (2009). « Le quartier artistique, un objet pour l’histoire urbaine », Histoire urbaine, n° 3, p. 5-20.
[11] Mommaas H. (2009). « Spaces of culture and economy: Mapping the cultural-creative cluster landscape », dans Kong L, O’Connor J (dir.), Creative economies, creative cities, Dordrecht, Springer, p. 45-59.
[12] Chapple K, Jackson S, Martin A. (2010). « Concentrating creativity: The planning of formal and informal arts districts », City, Culture and Society, n° 1(4), p. 225-234.
[13] Grésillon B. (2014). Géographie de l’art : ville et création artistique. Paris, Économica, 254 p.
[14] Baker T, Temenos C. (2015). « Urban policy mobilities research: introduction to a debate », International Journal of Urban and Regional Research, n° 39(4), p. 824-827.
[15] Ward K. (2006). “‘Policies in motion’, urban management and state restructuring: the trans-local expansion of business improvement districts”, International Journal of Urban and Regional Research, n° 30(1), p. 54-75.
[16] Allen J, Cochrane A. (2007). “Beyond the territorial fix: regional assemblages, politics and power”, Regional Studies, n° 41(9), p. 1161-1175.
[17] Gonzalez S. (2011). “Bilbao and Barcelona ‘in motion’. How regeneration ‘models’ travel and mutate in the global flows of policy tourism”, Urban Studies, n° 48(7), p. 1397-1418.
[18] Simpson C. (1981). SoHo, the Artist in the City, University of Chicago Press.
[19] Smith N. (2005). The new urban frontier: Gentrification and the revanchist city, Routledge.
[20] Marcuse P. (1997). « The enclave, the citadel, and the ghetto: What has changed in the post-Fordist US city », Urban affairs review, n° 33(2), p. 228-264.
[21] Scott A. (1997). « The cultural economy of cities », International journal of urban and regional research, n° 21(2), p. 323-339.
[22] Molotch H, Treskon M. (2009). « Changing art: SoHo, Chelsea and the dynamic geography of galleries in New York City », International Journal of Urban and Regional Research, vol. 33, n° 2, p. 517‐541.
[23] Andres L, Grésillon B. (2011). « Les figures de la friche dans les villes culturelles et créatives », L’Espace géographique, n° 40(1), p. 15-30.
[24] Molho J, Sagot-Duvauroux D. (2017). « From Global to Local Creative Dynamics: the Location Patterns of Art Galleries », dans Chapain C, Stryjakiewicz T (dir.), Creative Industries in Europe, Springer, Cham, p. 43-64.
[25] Ren X, Sun M. (2012). « Artistic urbanization: creative industries and creative control in Beijing », International journal of urban and regional research, vol. 36, n° 3, p. 504-521.
[26] Ithurbide C. (2012). Marché de l’art contemporain indien : territoires et réseaux en construction, Transcontinentales. Sociétés, idéologies, système mondial, n° 12/13.
[27] Molho J. (2014). « Territorialisation d’un marché de l’art émergent : le cas d’Istanbul », Belgeo. Revue belge de géographie, n° 3.
[28] Vivant E. (2007). « L’instrumentalisation de la culture dans les politiques urbaines : un modèle d’action transposable ? », Espaces et sociétés, n° 4, p. 49-66.
[29] Peck J. (2012). “Recreative city: Amsterdam, vehicular ideas and the adaptive spaces of creativity policy”. International Journal of Urban and Regional Research, n° 36(3), p. 462-485.
[30] Theodore N, Peck J. (2012). “Framing neoliberal urbanism: translating ‘commonsense’ urban policy across the OECD zone”, European Urban and Regional Studies, n° 19(1), p. 20-41.
[31] Op. cit.
[32] Moureau N, Sagot-Duvauroux D. (2016). Le marché de l’art contemporain, Paris, La Découverte.
[33] Evans, G. (2003). « Hard‐branding the cultural city–from Prado to Prada », International Journal of Urban and Regional Research, n° 27(2), p. 417-440.
[34] Zukin S. (2009). « Changing landscapes of power: Opulence and the urge for authenticity », International Journal of Urban and Regional Research, n° 33(2), p. 543-553.
[35] Novy J, Colomb C. (2013). « Struggling for the right to the (creative) city in Berlin and Hamburg: new urban social movements, new ‘spaces of hope’? », International Journal of Urban and Regional Research, n° 37(5), p. 1816-1838.
[36] McFarlane C. (2011). Learning the city: knowledge and translocal assemblage, Malden, MA, Blackwell.
[37] Arab N. (2007). « À quoi sert l’expérience des autres ? », Espaces et sociétés, n° 4, p. 33-47.
[38] Devisme L, Dumont M, Roy É. (2007). « Le jeu des “bonnes pratiques” dans les opérations urbaines, entre normes et fabrique locale », Espaces et sociétés, n° 4, p. 15-31.
[39] Verdeil É. (2005). « Expertises nomades au Sud. Éclairages sur la circulation des modèles urbains », Géocarrefour. Revue de géographie de Lyon, n° 80(3), p. 165-169.
[40] McCann E, Ward E (dir.). (2011). Mobile urbanism: cities and policymaking in the global age, Minneapolis, University of Minnesota Press.
[41] Sevin O. (2012). « Existe-t-il un modèle singapourien de développement urbain ? », Belgeo. Revue belge de géographie, n° 4.
[42] Huff G. (1995). « What is the Singapore model of economic development ? », Cambridge Journal of Economics, n° 19(6), p. 735-759.
[43] Phang SY. (2007). « The Singapore model of housing and the welfare state », dans Groves R, Murie A, Watson C (dir.), Housing and the New Welfare State: Perspectives from East Asia and Europe, Ashgate, p. 15-44.
[44] Goh M. (2002). « Congestion management and electronic road pricing in Singapore », Journal of Transport Geography, n° 10(1), p. 29-38.
[45] Shatkin G. (2014). « Reinterpreting the meaning of the “Singapore Model”: state capitalism and urban planning », International Journal of Urban and Regional Research, n° 38(1), p. 116-137.
[46] Shatkin évalue que les revenus de l’opération Marina Bay Sands a généré en tout un revenu de 36 milliards de dollars singapouriens entre 2006 et 2008, correspondant à plus de 20 % du budget national de la cité-État sur cette période.
[47] Nasir KM, Turner B. (2013). « Governing as gardening: reflections on soft authoritarianism in Singapore », Citizenship Studies, n° 17(3-4), p. 339-352.
[48] Dale OJ. (1999). Urban planning in Singapore: The transformation of a city, Oxford University Press.
[49] Marshall R. (2003). Emerging urbanity: global urban projects in the Asia Pacific Rim, London, Spon Press.
[50] Pow CP. (2014). « License to travel: Policy assemblage and the “Singapore model” ». City, n° 18(3), p. 287-306.
[51] Tan E. (2003). « Re-engaging Chineseness: Political, economic and cultural imperatives of nation-building in Singapore », The China Quarterly, n° 175, p. 751-774.
[52] Mutalib H. (2012). Singapore Malays: being ethnic minority and Muslim in a global city-state, Routledge.
[53] Yeoh B, Lin W. (2012). « Rapid Growth in Singapore’s Immigrant Population Brings Policy Challenges », The Online Journal of the Migration Policy Institute [En ligne].
[54] Yeoh B, Chang TC. (2001). « Globalising Singapore: debating transnational flows in the city », Urban Studies, n° 38(7), p. 1025-1044.
[55] Henderson J. (2005). « Planning, Changing Landscapes and Tourism in Singapore », Journal of Sustainable Tourism, n° 13, p. 2.
[56] Bereson R. (2003). “Renaissance or regurgitation? Arts policy in Singapore 1957-2003”, Asia Pacific Journal of Arts and Cultural Management, n° 1(1), p. 1-14.
[57] State of Singapore. (1959). State of Singapore Annual Report, Singapour, Government Printing Office of Singapore.
[58] Lee WK. (2003). « Creating a “city of art”: evaluating Singapore’s vision of becoming a renaissance city », thèse de doctorat, Massachusetts Institute of Technology.
[59] Rodan G, Jayasuriya K. (2009). « Capitalist development, regime transitions and new forms of authoritarianism in Asia », The Pacific Review, n° 22(1), p. 23-47.
[60] Kong L. (2000). “Cultural policy in Singapore: negotiating economic and socio-cultural agendas”, Geoforum, n° 31(4), p. 409-424.
[61] Un dollar singapourien équivaut à 0,67 euro.
[62] Op. cit.
[63] ACCA (Advisory Council on Cultural and the Arts). (1989) Report of the Advisory Council on Culture and the Arts, Singapour.
[64] Op. cit.
[65] Ministry for Information and the Arts (MITA) (2000) The Renaissance City Report: Culture and the arts in renaissance Singapore, MITA, Singapour.
[66] Entretien avec une responsable de NAC [E1].
[67] Ministry of Culture, Community and Youth (MCCY) (2013) Singapore Cultural Statistics, MCCY, Singapour
[68] Minister of Culture Community and Youth (MCCY). (2012). The report of the arts and culture strategic review [En ligne].
[69] Entretien avec une responsable d’EDB [E2].
[70] Op. cit.
[71] Op. cit.
[72] Ce modèle a été théorisé par le professeur en management de l’université d’Harvard, Michael Porter.
[73] Communiqué de presse : Singapore, 14 September 2012, NTU to drive Singapore’s new contemporary art centre at Gillman Barracks [En ligne].
[74] Shetty D. (2015). « Nearly a third of Gillman Barracks galleries have decided not to renew their leases », Straits Times, 11 avril [En ligne].
[75] Entretien avec un responsable de la principale foire de Singapore, Art Stage [E3].
[76] Tagore S. (2013). « What will make Singapore a world arts hub », The Malaysian Insider, 18 mars [En ligne].
[77] Entretien avec une employée de la galerie Faust [E4].
[78] Entretien avec une responsable de la galerie Arndt [E5].
[79] Yusof H. (2016a). « Has Gillman Barracks turned the corner? », Business Times, 24 juin [En ligne].
[80] Pour une surface de 320 m2, Arndt devait payer, en 2015, 11 500 dollars singapouriens (soit environ 7 500 euros) par mois.
[81] Op. cit.
[82] Yusof H. (2016b). « Gillman redefines role at its four-year mark », Business Times, 16 septembre [En ligne].
[83] Ibid.
[84] Devi R. (2017). « A camp with a difference », TODAYonline, 21 janvier [En ligne].
[85] Prospectus de présentation des œuvres du projet Drive, retrouvé sur la page Facebook des Gillman Barracks, publié en décembre 2014 [En ligne, août 2017].
[86] Op. cit.
[87] Op. cit.
[88] Harvey D. (2000). Spaces of hope, University of California Press.



